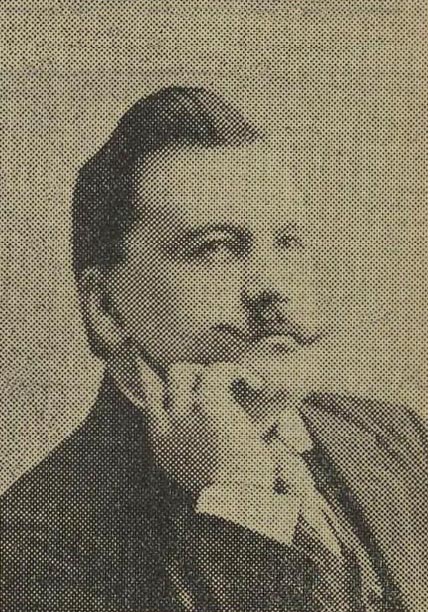
Jean MAJERSKI
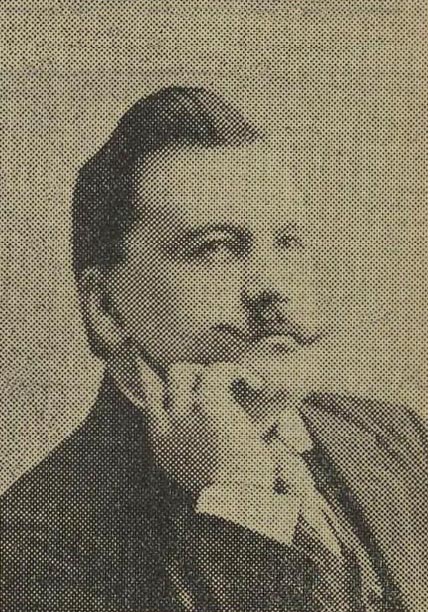
Jean Majerski en 1913 [photo Baudillon]
Jan de MAJERSKI dit Jean MAJERSKI
ténor polonais
( ap. 1913)
Epoux de Mlle de DUNIN.
Il fut engagé au Palais Garnier en novembre 1911. Le 01 juin 1913, il chanta Aïda (Radamès) au Théâtre de la Nature à Toulouse. Son nom a parfois été orthographié Majersky.
En 1914, il habitait 60 rue de la Faisanderie à Paris 16e.
|
Sa carrière à l'Opéra de Paris
Il y débuta le 30 août 1912 dans Samson et Dalila (Samson).
Il y chanta Aïda (Radamès, 1913). |
|
Opéra. Après une très brillante audition, MM. Messager et Broussan viennent d'engager un ténor, M. Majersky, qui débutera au mois de mai prochain. M. Majersky fut d'abord professeur de sciences à Lemberg, puis il travailla le chant et se fit connaître en Italie. Il a paru avec succès sur les scènes de Florence, Rome et Milan, (Comdia, 29 novembre 1911)
A l'Opéra. Les débuts de M. de Majersky Voici deux mois au moins que nous attendons les débuts de M. de Majersky, le ténor polonais que l'Opéra s'est mis en tête de produire à Paris, comme il avait produit M. Altchevsky et tant d'autres étoiles slaves. Voici deux mois qu'on nous dit : « Ça y est, c'est pour demain les débuts, notre ténor est prêt. » » Et le ténor n'est jamais prêt et l'on renvoie toujours à plus tard sa première audition et l'on nous donne pour nous faire prendre patience M. Cazenave, ancien représentant en souliers et sandales, que M. Broussan a découvert au pays basque récemment. Mais il paraît qu'aujourd'hui il ne saurait y avoir d'autre retard, que l'échéance de vendredi est définitive et qu'en cette soirée de vendredi, nous verrons, nous entendrons sûrement M. de Majersky dans Samson, avec Mlle Charny en Dalila. Je ne sais pas si ces débuts seront sensationnels, s'ils feront courir tout Paris à l'Opéra. Je crois cependant que pour faire courir Paris il faudrait autre chose que les si plus ou moins naturels de M. Majersky, mais ce n'est pas cela, au moins je l'imagine, que se proposent les directeurs de l'Opéra, satisfaits amplement s'ils font courir la colonie slave... Car, je ne pense pas et on n'a pas dit que M. de Majersky fût un ténor extraordinaire, et le choix de Samson ne l'indiqua pas davantage, car, disent les initiés, c'est Samson qu'on choisit au contraire lorsqu'on n'est pas très sûr d'un chanteur, Samson qui n'est pas très dur pour ténor, Samson dont les quelques notes pénibles, celles qui sont criées au haut du temple, au moment de l'écroulement, peuvent, sans que le public y voie quelque chose, être poussées par un choriste à voix. M. de Majersky, d'ailleurs, n'est pas un ténor de carrière et jusqu'en ces dernières années il professait les sciences à l'université de Lemberg (Pologne autrichienne). Et voici comme il quitta les sciences pour les arts... Il avait, dit l'histoire, parmi ses élèves le fils d'un haut personnage de la cour, qui, écolier peu brillant., avait plutôt à se plaindre des sévérités de M. de Majersky. Pour s'en débarrasser, il s'avisa de célébrer à son père, Mécène notoire, les talents vocaux de son professeur. Le père invita celui-ci à une soirée où il lui fit chanter, accompagné au piano par M. Dembowsky, ministre de l'instruction publique, divers airs de son répertoire, un air de la Walkyrie notamment.. Succès fou Un mois après, M. de Majersky lâchait sa chaire et débutait dans Aïda au théâtre de Lemberg. Bien entendu, je donne l'histoire comme on me la donna, s. g. d. g. (L. B., la Liberté, 27 août 1912)
Aïda au Théâtre de la Nature. Le rôle de Radamès est confié au fameux ténor Majerski, de l'Opéra, qui débuta à Paris dans ce même rôle où il fut une révélation. Jean Majerski est un ex-professeur de sciences du collège polonais de Lemberg, inventeur d'une ingénieuse méthode pour l'enseignement de la géométrie descriptive. Mais voilà qu'un beau jour, le jeune savant abandonne les mathématiques, et, poussé par le démon de l'art, se lance dans le théâtre ; l'empereur d'Autriche fut frappé de ses dispositions et lui octroie un congé de trois ans, et peu de temps après, il débute à l'Opéra, à Paris. La voix de cet extraordinaire ténor est d'une force étonnante, claire, cuivrée, surtout dans les notes du haut, elle ne décèle pas le moindre accent étranger, et elle est accompagnée d'une attitude noble et d'un beau geste scénique. (le Midi socialiste, 08 mai 1913)
|