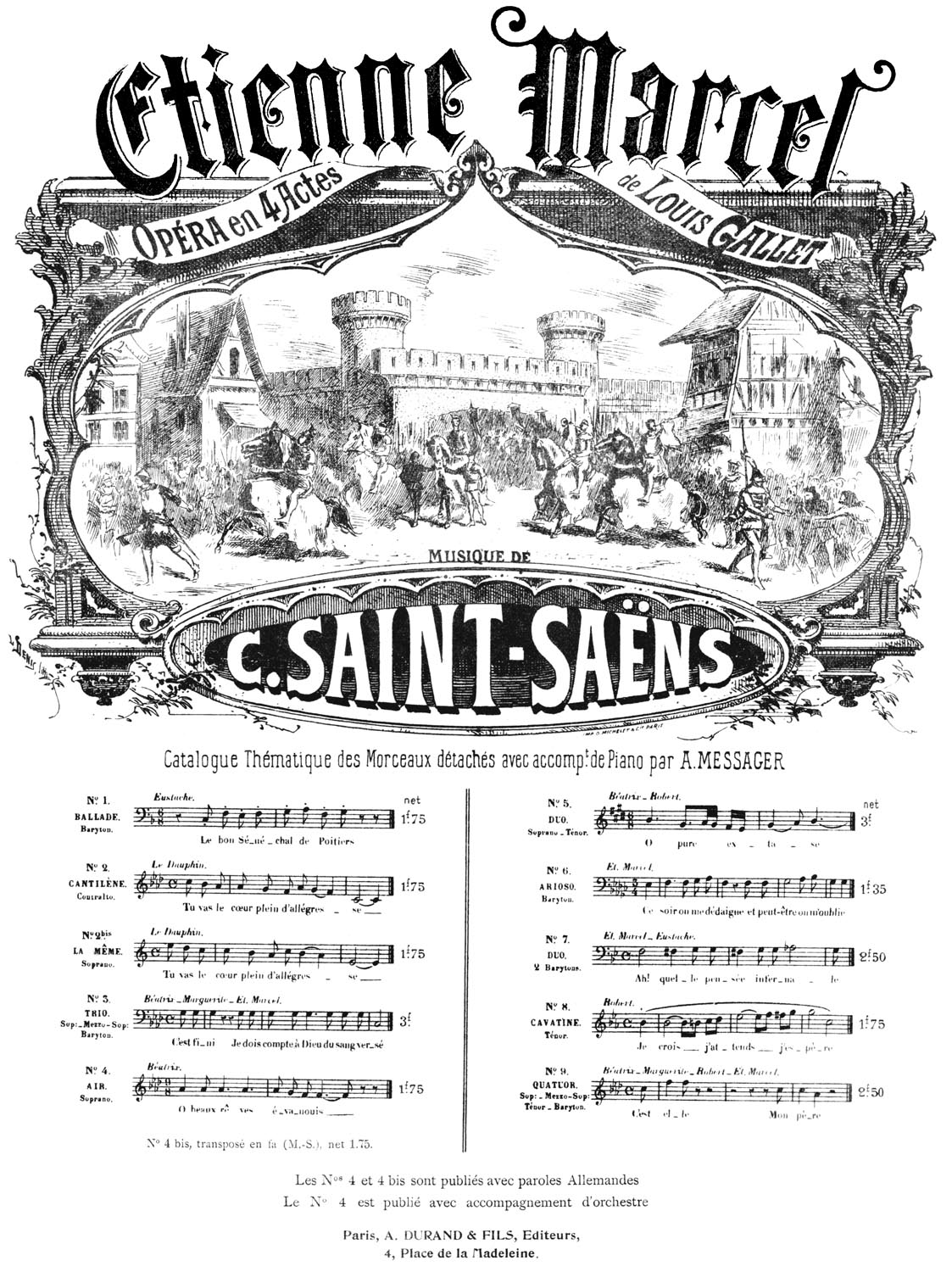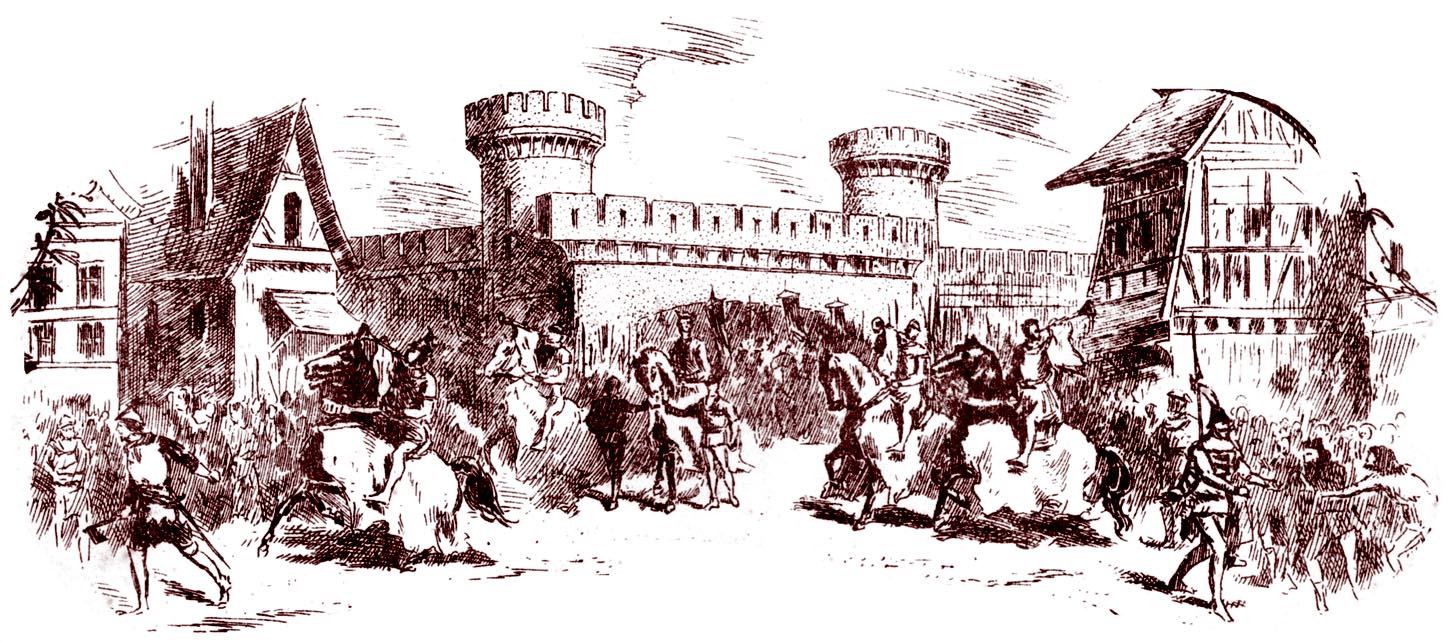
Étienne Marcel
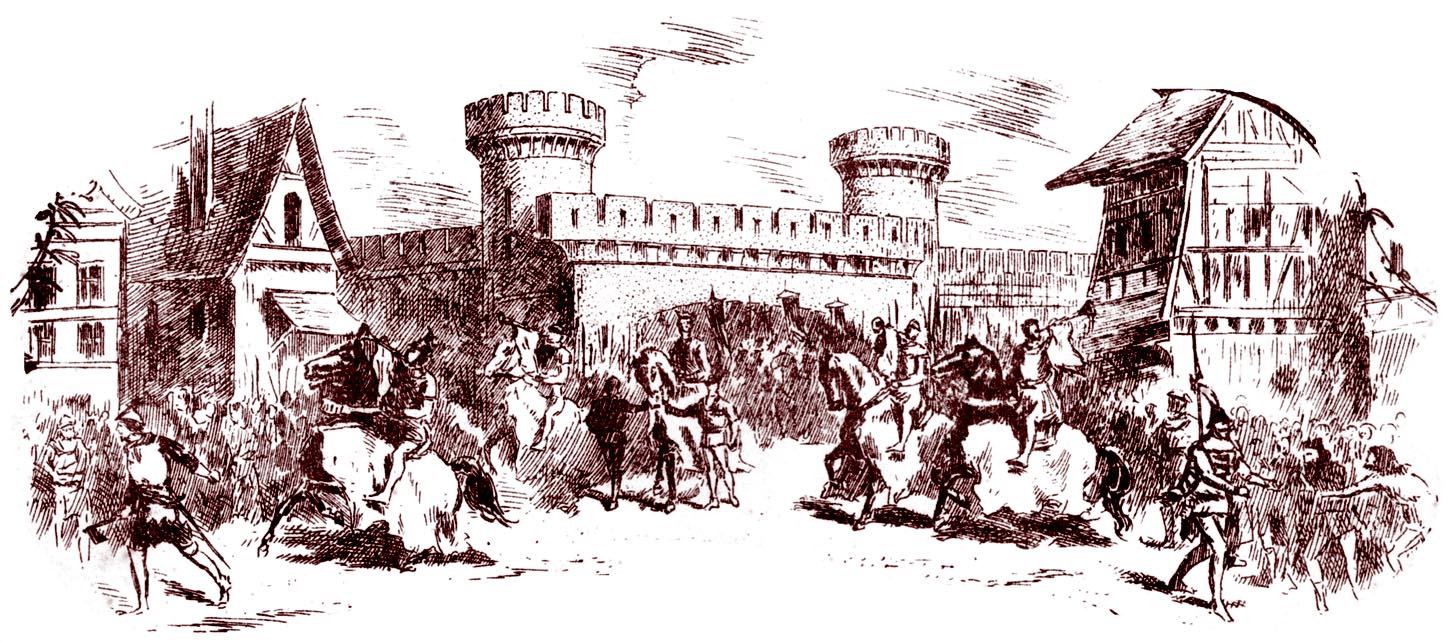
Opéra en quatre actes et six tableaux, livret de Louis GALLET, musique de Camille SAINT-SAËNS (composée en 1877-1878).
Création au Grand-Théâtre de Lyon le 08 février 1879.
Premières au Théâtre du Château-d'Eau à Paris le 24 octobre 1884, au Théâtre des Arts de Rouen le 26 mars 1885, au théâtre de Monte-Carlo le 07 mars 1918.
|
personnages |
emplois |
créateurs |
| Béatrix Marcel, fille du prévôt | soprano Falcon | Mmes Reine MÉZERAY |
| le Dauphin Charles | contralto | Amélie LUIGINI |
| Marguerite, mère de Béatrix | mezzo-soprano | LEGÉNISEL-MONNIER |
| Étienne Marcel, prévôt des marchands | 1er baryton | MM. Michel DELRAT |
| Robert de Loris, écuyer du Dauphin | ténor | Théodore STÉPHANNE |
| Eustache | 2e baryton | Pol PLANÇON |
| Robert de Clermont, maréchal de Normandie | basse chantante | DE GRAVE |
| Jehan Maillard | basse | Louis Henri ECHETTO |
| Pierre, jeune seigneur, ami de Robert | 2e ténor | BARON |
| l'Hôtelier | trial | NERVAL |
| un Héraut | ténor | BONNEFOND |
| un Artisan | baryton | MORFER |
| Denis, serviteur de Marcel | ténor | FRÉDÉRIC |
| un Soldat | ténor | |
| Josseran de Mâcon, trésorier du roi de Navarre | coryphée | |
| Lecoq, évêque de Laon | coryphée | |
| un Echevin | coryphée | |
| Marion, suivante de Béatrix | coryphée | |
| Seigneurs, Echevins, Artisans, Bourgeois, Pages, Ecuyers, Soldats, Clercs, Ecoliers, Ribaudes, Bohémiens, Filles d'Egypte, etc. | ||
| Chef d'orchestre | Camille SAINT-SAËNS |
La scène est à Paris, sous la régence du Dauphin Charles, pendant la captivité du roi Jean le Bon en Angleterre. Février-Août 1358.
|
La pièce est intéressante et offre des situations très dramatiques, dont plusieurs rappellent celles des Huguenots et de la Juive. Elle était de nature à fournir à un compositeur doué d'inspiration l'occasion d'ajouter un ouvrage au répertoire français. Les personnages sont : Etienne Marcel, prévôt des marchand ; sa fille Béatrix ; Robert de Loris, écuyer du dauphin et amoureux de Beatrix ; Eustache, aventurier et âme damnée du prévôt ; Jean Maillard, quartenier ; le dauphin ; Robert de Clermont, maréchal de Normandie ; Marguerite, femme d'Étienne Marcel ; l'évêque de Laon, Robert Lecocq ; Pierre, ami de Robert de Loris. Au premier acte, les hommes du peuple, excités par Eustache, témoignent leur aversion pour les gens du roi et se disposent à la révolte. Béatrix, insultée par quelques soldats, est protégée et délivrée par Robert de Loris. Etienne Marcel arrive sur ces entrefaites, remercie froidement le libérateur de sa fille et soupçonne les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Un crieur annonce la condamnation d'un bourgeois nommé Perrin Marc, qui a assassiné le trésorier du dauphin. Cette nouvelle est accueillie avec fureur par les mécontents, qui, excités par l'évêque de Laon et Eustache, demandent à Etienne Marcel de se mettre à leur tête. Celui-ci accepte, malgré les remontrances de Jean Maillard :
Prends garde, compagnon, Dangereux sont tes rêves ; Sers notre liberté, mais sans trahir le roi ! Les colères que tu soulèves Se retourneront contre toi !
Étienne Marcel répond par le cri : Aux armes ! répété par les gens qui l'entourent. Dans le second acte, le dauphin confie à son écuyer les ennuis qui l'obsèdent :
Parfois je songe en ma tristesse A m'enfuir loin de cette cour, Libre de soins, l'âme en liesse, Ivre de soleil et d'amour. Mais hélas ! que cette heure est brève ! Ma grandeur, à tous les instants, Brisant les ailes de mon rêve, Fait s'évanouir ce printemps. Chaque matin, sous le jour pâle, Se dresse le même horizon, Et cette demeure royale Est morne comme une prison.
Le musicien aurait pu rendre le dauphin intéressant en lui faisant chanter sur ces paroles un air, une cavatine développée, au lieu d'un cantabile syllabique dont la mélodie est écourtée. Mais l'école à laquelle il s'est affilié affecte de supprimer dédaigneusement les dénominations usuelles des morceaux d’une partition pour ne les désigner que par le numéro de la scène, de sorte qu'il n'y a ni duos, ni trios, ni quatuors, mais une suite de récits coupés de loin en loin par des chœurs ; cette théorie, qui transforme une œuvre dramatique en une mélopée récitante, est commode pour dissimuler la pénurie d'idées ; mais elle ne saurait être appliquée avec logique par ceux-là même qui la préconisent faute d'avoir en eux les inspirations nécessaires pour intéresser et plaire. Ils placent dans l'orchestre et çà et là dans la partie vocale tout ce que leur imagination avare leur fournit de mélodie, et l'on n'est pas peu surpris de la banalité et du style plat de ces phrases courtes, dont la valeur s'accorde si peu avec les prétentions novatrices de ces messieurs, qui se sont nommés eux-mêmes musiciens de l'avenir pour escompter dans le présent les avantages qu'un public facile à séduire attribue volontiers à ceux qui lui promettent du nouveau. Les insurgés envahissent le palais et massacrent aux pieds du dauphin Robert de Clermont, maréchal de Normandie. L'histoire fait mention d'une autre victime de la fureur populaire, de Jean de Conflans, maréchal de Champagne ; mais le librettiste a pensé avec raison que le meurtre d'un seul personnage était suffisant dans un opéra ; seulement, au dénouement, il aurait peut-être mieux obéi aux convenances dramatiques en faisant punir Étienne Marcel de sa trahison sur la scène plutôt que dans la coulisse. Robert de Loris veut venger la mort du maréchal ; la populace va lui faire un mauvais parti ; Étienne Marcel s'acquitte de sa dette envers lui en le protégeant à son tour. La scène du chaperon aux couleurs de la ville de Paris, placé sur la tête du dauphin, n'a pas été omise. Dans un second tableau, une scène domestique a lieu entre le père qui annonce la fausse nouvelle de la mort de Robert de Loris, et sa fille, dont la douleur trahit l'amour. Les paroles du livret sont très négligées en cet endroit pathétique. Étienne Marcel accable Béatrix de reproches et la menace de tuer celui qu'elle ose aimer. Marguerite intercède en vain. La musique de cette scène n'est que violente et n'a aucune valeur musicale. Le chant de Béatrix restée seule : O beaux rêves évanouis ! sans offrir d'idée neuve, est d'une expression juste. Ici se place, désigné sous le nom de scène V, un véritable duo d'amour. Robert est auprès de sa bien-aimée ; il veut l'entraîner, et, au moment où elle va céder à ses instances et quitter la demeure de ses parents, on frappe à la porte et des insurgés appellent Marcel. Béatrix décide son amant à fuir leur colère en passant par une porte dérobée ; mais, au moment où il va la franchir, Étienne Marcel entre, ouvre la porte du fond qui donne passage à la foule ; on se précipite sur Robert qui se fait place l'épée à la main et saute par la fenêtre. Ce finale est, comme ou le voit, assez mal conduit, et la jeune fille y joue un rôle peu convenable. Quant à la musique, on remarque dans le duo une phrase adagio : Interroge les astres d'or, et une autre phrase : O pure extase ; le reste n'offre que des effets de sonorité obtenus par de fréquents unissons. Le troisième acte a lieu devant Notre-Dame. On fête la Saint-Jean. Le peuple est en liesse ; on danse. Le ballet est fort long et varié. Le meilleur morceau est intitulé : Musette guerrière. Étienne Marcel, entouré des échevins, est reçu par l'évêque de Laon avec une grande solennité. Robert, déguisé en mendiant, s'approche de Béatrix, lui dit que la fin du pouvoir usurpé par son père est prochaine, qu'il sauvera ses jours, mais qu'elle doit fuir avec lui. Au moment où Béatrix donne son consentement à un nouveau projet de fuite avec son amant, Robert est reconnu par Eustache et encore une fois livré à la colère de Marcel ; mais il s'est produit dans le peuple un revirement subit contre le prévôt. Jean Maillard lui tient tête, et, appuyé par le populaire à sen tour, délivre le prisonnier. Eustache, espion du roi de Navarre Charles le Mauvais, profite de la sombre tristesse et des appréhensions du prévôt des marchands pour l'engager à lui ouvrir les portes de Paris. Après quelques hésitations, celui-ci se décide à commettre cette trahison. Dans cet acte, Marcel chante un récit mesuré qui ne manque pas de caractère : Ce soir on me dédaigne et peut-être on m'oublie. Le dialogue entre Marcel et Eustache est aussi bien traité ; mais la scène de la délivrance du prisonnier n'a pas un sens suffisant. On peut admettre une grande sonorité dans une scène populaire, mais encore faut-il que le jugement de l'oreille ne perde pas ses droits. On se transporte au dernier acte à la bastille Saint-Denis. Jean Maillard veille et s'assure de la fidélité des gardes du poste. Lorsque Étienne Marcel demande les clefs de la ville, elles lui sont refusées. Robert a surpris le secret de Marcel ; n'écoutant que sa générosité et son amour pour Béatrix, il lui garantit le pardon du dauphin s'il veut renoncer à ses projets. Beatrix et Marguerite joignent leurs prières aux siennes ; cette scène de famille touche au ridicule. Étienne Marcel résiste à tout, se précipite au dehors suivi de quelques partisans et tombe frappé par Jean Maillard. La pièce se termine par l'entrée triomphale du dauphin. Les morceaux à signaler dans cet acte sont : une marche orchestrale assez alambiquée, l'air de ténor chanté par Robert et un quatuor final qui souvent n'est qu'un trio à cause des unissons prolongés.
(Félix Clément, Dictionnaire des opéras, supplément, 1880) |