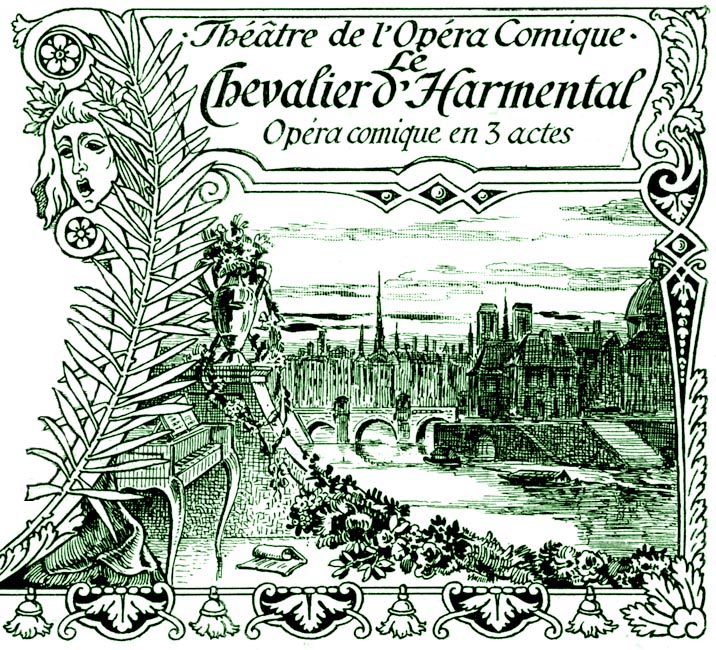
le Chevalier d'Harmental
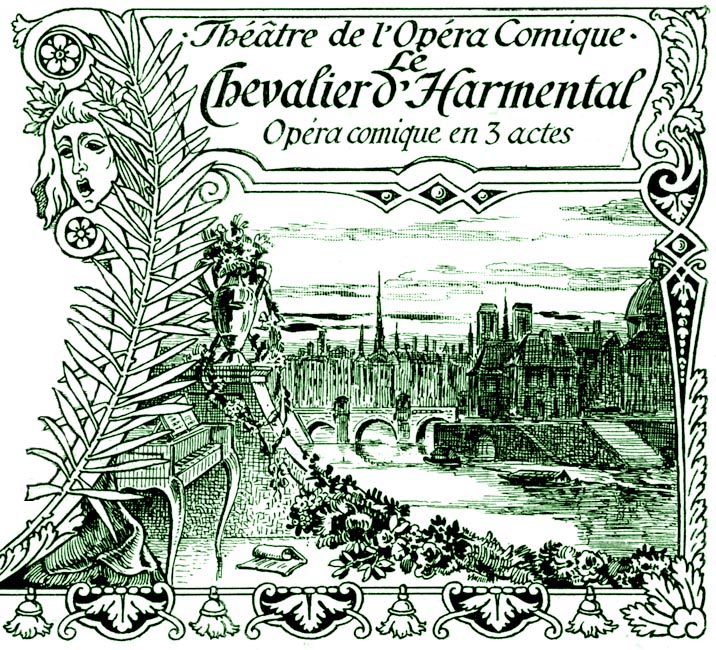
frontispice pour un air du Chevalier d'Harmental édité le 25 avril 1896
Opéra-comique en cinq actes et six tableaux, livret de Paul FERRIER, d'après le Chevalier d'Harmental, drame en cinq actes d'Alexandre Dumas et Auguste Maquet, musique d’André MESSAGER.
Le drame de Dumas et Maquet a été créé au Théâtre Historique le 26 juillet 1849 avec une musique d'Alphonse Varney.
air de danse (acte I), édité le 25 avril 1896
Création à l'Opéra-Comique (salle du Châtelet) le 05 mai 1896.
|
personnages |
emplois |
créateurs |
| Bathilde Durocher | soprano | Mmes Jane MARIGNAN |
| la Duchesse du Maine | mezzo-soprano | Esther CHEVALIER |
| Madame Denis | mezzo-soprano | Jane EVEL |
| Raoul, chevalier d'Harmental | ténor | MM. Julien LEPRESTRE |
| Buvat | baryton | Lucien FUGÈRE |
| l'Abbé Brigaud | ténor | Ernest CARBONNE |
| le Capitaine Roquefinette | basse | Jacques ISNARDON |
| Philippe d'Orléans, régent de France | baryton | MARC-NOHEL |
| La Fare | ténor | Maurice JACQUET |
| Ravanne | ténor | Tony THOMAS |
| Laval | ténor | RIVIÈRE |
| Richelieu | basse | César BERNAERT |
| Pompadour | baryton | Henri BERRIEL |
| Cellamare | basse | KARLONI |
| Jean Gargouille | ténor | CARREL |
| Maillefer | baryton | Etienne TROY |
| Chef d'orchestre | Jules DANBÉ |
La scène se passe à Paris, sous la Régence.

Jacques Isnardon (Roquefinette) lors de la création
|
Ce n'est pas la première fois que le Chevalier d'Harmental, l'un des plus intéressants romans d'Alexandre Dumas père, qui avait pris pour sujet de son action la fameuse conspiration de Cellamare, a été « mis en pièce ». Dumas lui-même, aidé de son fidèle Auguste Maquet, en tira naguère un grand drame en une infinité de tableaux, qu'il fit représenter, le 26 juillet 1849, au Théâtre-Historique du boulevard du Temple, fondé par lui et qui ne devait pas tarder à devenir le Théâtre-Lyrique. C'était l'excellent comédien Numa, pendant trente ans la joie du Gymnase, qui, engagé spécialement à cet effet, créait dans ce drame le rôle du bonhomme Buvat, que M. Fugère vient de mettre en relief dans l'œuvre nouvelle avec un si grand succès, un de ces succès dont il est coutumier. Il y avait certainement, dans le Chevalier d’Harmental, les éléments d’un bon livret d'opéra-comique, comme Planard a prouvé, dans le Pré-aux-Clercs, que ces éléments se trouvaient dans la Chronique du temps de Charles IX de Mérimée. Mais je n'hésite pas à dire que Planard a été plus heureux que M. Paul Ferrier, qui est pourtant un habile ouvrier en matière de théâtre. Tout d'abord, M. Ferrier a eu un tort : c'est, écrivant un véritable opéra-comique, de ne pas adopter franchement la forme consacrée au genre en donnant au dialogue une part importante. C'est à peine si l'on entend, dans le Chevalier d'Harmental, quelques bouts de phrases parlées. Or, la pièce est une pièce d'intrigue, qui devrait marcher rapidement, aller droit à son but, et où les conversations des personnages, les explications données indirectement par eux au public devraient avoir le caractère alerte, la promptitude, la vivacité du langage ordinaire. Au lieu de cela, nous avons constamment un récitatif qui assombrit, qui alourdit, qui alanguit l’action, et qui pèse sur elle comme pèseraient des semelles de plomb aux pieds d'un coureur. Les musiciens italiens, lorsqu'ils écrivaient encore de la musique bouffe ou de demi-caractère, employaient, à la place de notre dialogue, un recitativo secco très peu accompagné, pour lequel ils avaient à leur service une langue vivace, rapide, facile en élisions, sans e muets, sans syllabes sourdes, dont ils pouvaient à volonté précipiter les périodes. Qu'on se rappelle les récitatifs si alertes du Barbier, de Don Pasquale ou de Crispino e la Comare. Nous n'avons pas cet avantage au point de vue musical ; notre langue n'a ni la prestesse, ni la désinvolture, ni l'étonnante légèreté de la langue italienne. Il en résulte que, au moins en certains cas, le langage parlé est chez nous une nécessité, notre dialogue lyrique étant forcément lent, trop mesuré et contraire à la nécessaire activité de l'action, activité à laquelle l'intervention de l'orchestre vient encore mettre obstacle, outre qu'elle empêche l'auditeur d'entendre les paroles. Tout cela me semble si vrai que le mot italien recitativo s'est surtout traduit en français par celui de récit, qui modifie sa signification et qui en indique la lourdeur et la lenteur relatives. Dans une pièce qui, comme le Chevalier d’Harmental, n'est autre chose qu'une comédie lyrique, on ne doit donc pas employer le même procédé que dans le drame musical. Mais il est temps de dire ce qu'est cette pièce. On sait que le duc du Maine, fils légitimé de Louis XIV et de Mme de Montespan, avait été désigné, dans le testament du grand roi, pour exercer une partie de la régence durant la minorité de Louis XV. Cela ne faisait pas l'affaire du duc d'Orléans, qui trouva le moyen de faire casser le testament pour accaparer la régence à lui tout seul. La duchesse du Maine, petite-fille du grand Condé, maîtresse femme et fort ambitieuse, qui tenait à Sceaux une sorte de cour, poussa alors son mari à prendre part à la conspiration que le prince de Cellamare, ambassadeur d'Espagne, avait ourdie dans le but de renverser le Régent. C'est précisément à Sceaux que s'ouvre l'action du Chevalier d'Harmental, pendant un bal donné par la duchesse, bal brillant qui évoque dans notre esprit le souvenir de ces fêtes quasi royales, si célèbres sous le nom des « Nuits de Sceaux », en faisant revivre à nos yeux les figures du poète Malézieux, du compositeur Mouret et de cette toute charmante Mme de Staal, dont les mémoires sont empreints d'un intérêt si touchant. C'est là, pendant le bal, que se réunissent les conspirateurs, et à leur tête le chevalier Raoul d'Harmental, qui viennent prendre le mot d'ordre de la duchesse. Les préparatifs de la conjuration n'empêchent point toutefois Raoul de devenir amoureux à première vue d'une jeune fille, Bathilde Durocher, appelée inopinément, à venir remplacer, dans les intermèdes du bal, une cantatrice de l'Opéra, indisposée. Mais Bathilde, orpheline et pupille en quelque sorte du vieil employé Buvat, qui l'a recueillie et avec lequel elle vit modestement, est une fille honnête et pure, ce qui ne fait que redoubler la passion du chevalier. Après l'avoir perdue de vue, il la cherche, la retrouve, lui fait partager sa tendresse et lui jure de l'épouser. Cependant, les conjurés ont décidé d'enlever le duc d'Orléans et de le faire prisonnier, et c'est Raoul qui, aidé de quelques affidés, parmi lesquels le capitaine Roquefinette, un soudard émérite, doit s'emparer lui-même de sa personne. Ils l'attendent, la nuit, dans la rue des Bons-Enfants, au sortir d'une maison où, en compagnie de son ami La Fare, il va faire une de ses orgies habituelles. Mais un incident fait manquer le coup, en même temps qu'il fait connaitre au Régent ce qui se tramait contre lui. Il va sans dire que le lieutenant de police est aussitôt avisé des faits. Celui-ci na tarda pas à mettre la main sur les conspirateurs, et d'Harmental, arrêté avec ses complices, paiera de sa tête le projet criminel auquel il s'était associé. Raoul savait à quoi il s'exposait en cas de défaite. Il est donc résigné à son sort, et demande seulement la grâce, qui lui est refusée, de donner son nom à Bathilde et de l'épouser avant de mourir. Mais Bathilde, on le conçoit, est au comble de la douleur. Pourtant il lui reste un rayon d'espoir. Elle ira se jeter aux pieds du Régent et lui donner connaissance d'une lettre que depuis dix ans elle cherche en vain à lui faire parvenir. Elle pénètre en effet près de lui, et lui communique cette lettre, qui est ainsi conçue : « Votre mari, madame, est tombé pour la France et pour moi. Ni la France ni moi ne pouvons vous le rendre. Mais si jamais, pour vous aider ou vous défendre, quel que soit le besoin, quel que soit le secours, vous recourez à nous, la France et moi sommes vos débiteurs. Philippe d’Orléans. » Cette lettre est du Régent lui-même, qui l'avait écrite à la veuve de l'officier Durocher, lequel, après lui avoir sauvé la vie à Nerwinde, avait trouvé la mort sous les murs d'Almanza. Philippe demande alors à la jeune fille ce qu'elle souhaite de lui, et elle le supplie de lui accorder la grâce de la vie, sinon de la liberté, pour celui qu'elle aime. Il refuse, mais il consent du moins à ce que le chevalier épouse, avant de mourir, celle à qui il a promis son nom. La cérémonie sera célébrée aussitôt, dans la chapelle du palais, et Raoul, mandé immédiatement sur l'ordre du Régent, conduit sa fiancée à l'autel. Toutefois, Philippe est ébranlé, et l'intervention de l'excellent Buvat, qui vient à son tour implorer sa clémence, produit un effet décisif. Le Régent de France fera grâce au chef de la conspiration, et le chevalier l'apprend de sa propre bouche au retour de la chapelle. Telle est cette pièce, qui, si elle n'était, comme je l'ai dit, empêtrée dans d'interminables récitatifs et fâcheusement alourdie par eux, serait très acceptable et pourrait faire bonne figure. Passons maintenant à la part du musicien. M. André Messager est un des heureux de ce monde musical. Ayant à peine dépassé la quarantaine, c'est-à-dire à l'âge où tant d'autres essaient vainement de se produire, il s'est fait jouer dans tous les théâtres possibles, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, depuis les Folies-Bergère jusqu'à l'Opéra. Il a débuté aux Folies-Bergère par quelques ballets, dont un intitulé Fleur d'oranger. Puis il fut choisi pour terminer une pièce laissée inachevée par le pauvre Bernicat, François les Bas-bleus. Puis il donna aux Folies-Dramatiques la Fauvette du Temple et le Bourgeois de Calais, aux Bouffes-Parisiens la Béarnaise et le Mari de la Reine, à la Renaissance Isoline et Madame Chrysanthème, au Nouveau-Théâtre Miss Dollar et le ballet de Scaramouche (avec M. Georges Street), enfin, à l'Opéra-Comique la Basoche, et à l'Opéra le ballet des Deux Pigeons. En présence d'une fortune aussi rare, nous avons donc le droit d'être exigeants envers M. Messager, dont le talent, d'ailleurs indiscutable et fort distingué, est essentiellement sympathique et a été encouragé de toutes façons. L'auteur de la musique du Chevalier d’Harmental a-t-il tenu tout ce qu'on était en droit d'attendre de lui ? Je ne saurais, pour ma part, répondre à cette question par une affirmation absolue, et j'avoue que j'espérais mieux de M. Messager, musicien habile, artiste instruit, à l'esprit net, au talent de marque bien française, et qui ne se perd pas dans les subtilités nuageuses et les rêveries prétendues profondes de nos prétendus réformateurs. M. Messager sait parfaitement que le rythme et la tonalité, ces choses aujourd'hui dédaignées, sont les éléments essentiels de la musique même dramatique, que l'orchestre est fait pour escorter le chant et non pour l'étouffer, qu'ou peut, sans se déshonorer, faire entendre deux et même trois voix à la fois, et qu'enfin l'emploi farouche du leitmotiv n'est pas une condition indispensable du génie. Il sait tout cela, et il l'a prouvé. Il est enfin de race vraiment nationale, et il me paraît un de ceux sur lesquels nous avons droit de compter. Mais il me paraît aussi, et justement, que dans le Chevalier d'Harmental il a quelque peu trompé notre attente, qu'il ne s'est pas mis assez en frais d'imagination, et qu'il a pris trop volontiers pour de l'inspiration la première idée, pauvre ou banale, qui se présentait à lui. Si j'excepte le troisième acte, le plus court d'ailleurs, mais qui est excellent d'un bout à l'autre, parce qu'il est alerte, et vif, et bien en scène, je trouve sa partition languissante et monotone, sans saveur et sans nouveauté, trop portée à la déclamation, ou plutôt à un débit sans accent et sans relief, dont la froideur n'est pas rachetée par la lourdeur de récitatifs qu'accompagne un orchestre souvent trop compact et trop pesant. J'ajoute que sa prosodie est fréquemment vicieuse, et que la musique boite sous les paroles. J'ai signalé le troisième acte, celui de la rue des Bons-Enfants, où il s'est laissé emporter très heureusement par le mouvement de la scène. Là se trouve un trio bouffe excellent, de forme syllabique, franc du collier, alerte, vif et bien rythmé, et qui a emporté les applaudissements ; puis la chanson militaire de Roquefinette, très franche aussi : Les gros dragons à Malplaquet, qui, si elle n'est pas d'une très grande nouveauté, est du moins amusante avec ses pizzicati pittoresques de violons ; puis divers autres passages, entre autres le gentil fragment symphonique qui, à la fin, accompagne l'entrée de la patrouille. Pour le reste, je suis bien embarrassé de citer quelque chose qui sorte de l'ordinaire ou du médiocre. La cantilène de Buvat au premier acte : Quel indéfinissable charme..., que M. Fugère a fait bisser par son exquise façon de la dire, est en soi bien banale et bien pâle. La chanson à boire de Roquefinette, au second acte, ne vaut que par la franchise du dessin, mais est nulle. Si je m'arrête aux épisodes importants sous le rapport dramatique, je serai peut-être amené à me montrer plus sévère encore. Ainsi de la scène de Bathilde au quatrième acte, de son entrevue avec le Régent au cinquième et de son duo avec Raoul. Dans tout cela, l’auteur me paraît avoir complètement manqué d'élan et d'inspiration. Je me bornerai à louer, au point de vue général, la sobriété des moyens employés, l'intérêt souvent répandu dans l'orchestre, et ce qu'on pourrait appeler l'intelligence de l'ensemble. Je regrette de me montrer si parcimonieux en ce qui concerne l'éloge. Si la partition du Chevalier d’Harmental était l'œuvre d'un débutant, elle pourrait passer pour une promesse intéressante et appellerait de justes encouragement. Mais M. Messager est loin aujourd'hui d'être un débutant ; il a non seulement du savoir, mais de l’expérience, l'habitude du public et la connaissance de la scène. Son passé nous donne le droit d'être exigeants envers lui, et, pour ma part, c'est justement parce que son talent m'est sympathique et que j'ai confiance en lui que je me crois le droit de lui faire entendre ce qui me paraît la vérité. Or, ce qui me paraît cette fois la vérité, c’est qu'il s'est en partie trompé. Je souhaite malgré tout que le public me donne tort, mais j'avoue que je n'y compte guère. Il n'a qu'à se louer, toutefois, de ses interprètes, qui ont défendu son œuvre avec vaillance. Ici je ferai comme l'affiche et je nommerai en premier lieu M. Fugère, qu'il faut effectivement tirer hors de pair, et qui a composé le rôle de Buvat avec le soin et l'originalité dont il marque chacune de ses créations ; car Fugère est comédien aussi intéressant que chanteur éprouvé. Fugère est doué naturellement de cette faculté si rare d'avoir de l'émotion dans la voix quand il chante, et comme avec cela il chante d'une façon exquise, il lui arrive de faire prendre le change au public sur la valeur vraie de telle ou telle phrase musicale, parfaitement insignifiante par elle-même, C'est ce qui s'est produit particulièrement au premier acte, dans une cantilène assez pâle que j'ai signalée, et que la salle lui a redemandée tout d'une voix. Comme comédien, il a fait merveille surtout au cinquième acte, dans sa scène avec le Régent. C'est M. Leprestre qui représente le chevalier Raoul d'Harmental, et il n'y aurait que des éloges à lui adresser s'il n'avait la fâcheuse habitude, qui à la longue devient irritante, d'enfler régulièrement le son après l'avoir émis piano, pour le laisser ensuite s'éteindre avec la même régularité ; on ne saurait croire combien ce procédé vicieux est fatigant pour l'auditeur. Toute réserve faite sur ce point important, M. Leprestre a bien mérité des auteurs. Mlle Marignan, dont c'était la première création, est une gracieuse et touchante Bathilde. Elle a marqué ce rôle au coin d'une tendresse aimable, tant au point de vue vocal qu'au point de vue scénique. Peut-être, toutefois, peut-on lui reprocher quelque abus de gestes et de mouvements. Mais il faut louer chez elle des accents d'une émotion sincère. Deux rôles de second plan, mais fort importants chacun en leur genre, sont tenus avec un véritable talent, l'un, le capitaine Roquefinette, par M. Isnardon, l'autre, le Régent, par M. Marc Nohel. M. Isnardon a fait un type excellent et fort original de cette espèce de chef de reîtres, auquel il a donné une physionomie pittoresque et vive ; j'ajoute qu'il l'a chanté avec beaucoup de verve et d'entrain, et que sa belle voix y sonne avec éclat. Quant à M. Marc Nohel, il a prêté au caractère du Régent la dignité froide qui lui convient en la circonstance, et il a joué ce rôle, plus difficile que brillant, avec une véritable autorité. M. Carbonne est un abbé Brigaud agréable quoique peut-être un peu exubérant, Mlle Chevalier est une fort belle duchesse du Maine, et Mlle Evel est tout accorte et tout aimable dans le petit rôle de Mme Denis. L'exécution d'ensemble est d'ailleurs excellente. (Arthur Pougin, le Ménestrel, 10 mai 1896)
|
|
Ce qui me plaît le plus dans le Chevalier d'Harmental que vient de représenter l'Opéra-Comique, c'est le troisième tableau et le cinquième ; l'un mouvementé, pittoresque, bien français en sa conception et en sa forme, l'autre, d'une ordonnance simple, favorable à l'expression musicale. Le reste est d'un genre mixte qui, adopté par le librettiste et le musicien, les montre inquiets de réaliser une formule d'art qui réponde aux exigences de l'esthétique actuellement en faveur. Il n'y avait pourtant pas à se préoccuper tant de cet accommodement laborieux.
On demande aujourd'hui un vrai drame lyrique, une vraie comédie lyrique ou encore un vrai opéra-comique dans le goût ancien ; on veut seulement que l'œuvre offerte au public soit, de propos délibéré, l'une de ces trois choses. Or le sujet du Chevalier d'Harmental, emprunté à l'abondant répertoire de Dumas, n'est ni assez haut pour donner un pur drame lyrique, ni assez essentiellement musical et léger pour donner une comédie lyrique. C'est une action parfois compliquée et peu musicable, que traversent des motifs, de caractère gai ou sentimental, ce qui est le propre du vieil opéra-comique aimé de nos pères.
II y fallait du dialogue sans musique, c'est indiscutable, un dialogue qui eût éclairé l'action et ainsi préparé, mis en valeur, les parties destinées à la pure expression lyrique des sentiments et des passions.
De même que, selon le mot ironique de Beaumarchais, ce qui ne vaut pas la peine d'être dit on le chante, ce qui ne vaut pas la peine d'être chanté on le dit. Ce qui vaut la peine d'être dit ici, c'est précisément, il y faut insister, ce qui porte la lumière à travers les événements du drame.
Pour ne l'avoir pas franchement admis, les auteurs ont couru grand risque de n'être pas toujours compris ou de ne pas toujours bien s'exprimer.
J'ai bien des fois, ici même, depuis quinze ans, exprimé mon antipathie pour ce genre hybride de l'opéra-comique, qui fait tour à tour parler et chanter les personnages, comme s'ils s'expliquaient en deux langues, au hasard de la conversation. L'expérience m'oblige à reconnaître que, pour les œuvres d'un certain tempérament, cette association fâcheuse est cependant préférable à un jargon pénible à supporter dans un dialogue parfois terriblement banal, auquel serait supérieur même le parlante des vieux opéras italiens qui, sans prétention musicale, uniquement pour ne pas revenir à la simple prose et garder une apparence de logique, déblayait rapidement et sèchement tout ce qui n'était qu'explication et préparation.
M. Paul Ferrier est un de nos auteurs les plus féconds et les plus avisés ; M. André Messager un de nos compositeurs les plus distingués, possédant la connaissance profonde de son art ; il semble ici que tous deux pourtant se soient trouvés un peu dépaysés et aient été amenés à forcer leur talent, à le vouloir hausser au ton qu'ils pensaient être celui d'une maison dans laquelle il ne fallait point tant de cérémonie. Ils eussent gagné à y parler avec leur bonne grâce et leur esprit naturels.
Cette grâce et cet esprit éclatent pourtant en maintes pages. Ce fâcheux dialogue chanté mis à l'écart, où la musique s'enfle fâcheusement pour dire des riens et nous faire prendre les vessies de l'obscure prose pour les lanternes de la vraie musique, il y a de quoi séduire et charmer dans cette partition.
Les chœurs, richesse inutile, concession à l'ancien régime, sont bien faits, d'une jolie coloration et d'un tour assez vivant. On trouve, dans le premier acte, l'agréable épisode de la « Reine de la nuit », intermède de concert introduit dans l'ordonnance de cet acte pour en corriger l'aridité, car il est presque tout entier consacré à une exposition dramatique. Je note à la suite de cet épisode la charmante et touchante expansion du bonhomme Buvat, faite pour ravir le public, surtout dite par cet admirable artiste qu'est Fugère, si simple, si naturellement ému, donnant toujours si précisément la note juste de son rôle.
Au second acte, où le sentiment amoureux s'exprime en traits délicats et discrets, une amusante boutade : « Capitaine, ne bois qu'à la fontaine », éclaire d'un joli rayon de soleil la grisaille du fond. Et le rideau tombe sur une impression furtive de poésie et de chaste amour, dénouement meilleur en sa sobriété que beaucoup de bruyants artifices de métier.
Puis c'est ce troisième tableau que j'ai noté au début de ces lignes. Très anecdotique, il passe devant nous d'une allure légère, où se décèlent toute la grâce native et le subtil tour d'esprit du compositeur. C'est d'abord la scène des malandrins, joyeux coquins rôdant sous l'ombre en l'attente d'un mauvais coup, types à la Callot, d'une main tendant pour l'aumône leur feutre barbelé, et de l'autre caressant, sous le manteau en loques, la poignée d'une rapière ou la crosse d'un pistolet. C'est la gaie et cavalière chanson des dragons de Malplaquet, dite par l'aventurier Roquefinette, pour faire passer plus vite l'heure de la nocturne veille, et dérouter l'attention des bons bourgeois et du Régent, attardé en un souper galant, et que l'on guette pour le prendre et l'expédier en Espagne, ainsi qu'il est dit dans le roman du bon conteur Dumas, que tout le monde a lu, ce qui me dispense ici de l'analyse du livret de M. Paul Ferrier. C'est enfin la jolie scène de l’apeurement de Buvat, perdu seul au tard de la nuit, dans l'obscure rue des Bons-Enfants, au milieu d'ombres grouillantes et menaçantes.
Au milieu de ces épisodes légers l'action se meut lentement et n'avance que très peu ; mais cela est amusant à voir passer et à entendre, ce qui est le principal.
Un air d'amour et un duo très tendre sont les points les plus lumineux du quatrième tableau. Le dernier, je l'ai dit aussi déjà, m'apparaît le mieux tenu, le mieux venu en son unité dramatique. Là encore le bonhomme Buvat a très supérieurement, avec une diversité remarquable d'effets, traduit une des plus importantes pages de l'ouvrage, récit animé, phrases attendries, qui ont soulevé des tonnerres d'applaudissements.
A côté de ce merveilleux Fugère, Mme Marignan, M. Leprestre, ont eu leur légitime part de succès. J'aurais, sur l'un et l'autre, quelques réflexions à faire ; mais la part des éloges dus étant la plus forte, je m'en tiendrai à ce principal et négligerai les points accessoires. M. Isnardon fait un très amusant et mordant Roquefinette. C'est un artiste d'avenir en ces rôles caractérisés où il faut à la fois être fin comédien et bon chanteur.
Mlle Chevalier est charmante sous le frais visage et les nobles atours de la duchesse du Maine, artiste précieuse pour le théâtre de l'Opéra-Comique, où son souple talent nous la montre à son avantage dans les rôles les plus divers.
M. Carbonne (l'abbé Brigaud), Marc Nohel (le Régent), Mme Evel, une très agréable débutante, complètent fort bien le gros de cette interprétation. Viennent ensuite une dizaine de petits rôles qui, confiés à des artistes expérimentés, tels que M. Troy, pour ne citer que le plus ancien, font honneur à la parfaite discipline et au goût de cette excellente troupe de notre second théâtre national de musique. L'orchestre est supérieurement mené par M. Danbé.
Les décors, très beaux, d'un goût irréprochable, — comme les costumes, — sont tels qu'on les attendait de M. Carvalho, qui voit merveilleusement, d'un œil fin de peintre, les tableaux qu'il nous fait présenter par ses collaborateurs, les décorateurs et les costumiers.
Quelle satisfaction lui apportera le Chevalier d'Harmental ? Je la lui souhaite grande et fructueuse, proportionnée à la constance de ses efforts pour faire bien, pour suivre dans ses fluctuations l'opinion parfois très déconcertante, pour fixer l'esprit de ses auteurs, parfois déroutés et désorientés, hypnotisés par quelque point lumineux qui vacille là-bas devant leurs yeux, et ne voyant pas immédiatement sous leurs pas un fossé où ils peuvent tomber ou tout simplement un tas de jolies fleurettes qu'ils pourraient cueillir pour notre agrément.
(Louis Gallet, la Nouvelle Revue, 15 mai 1896)
|
|
Ouvrage manqué malgré le talent bien connu de ses auteurs. Succès nul.
(Félix Clément, Dictionnaire des opéras, supplément d’Arthur Pougin, 1904)
|