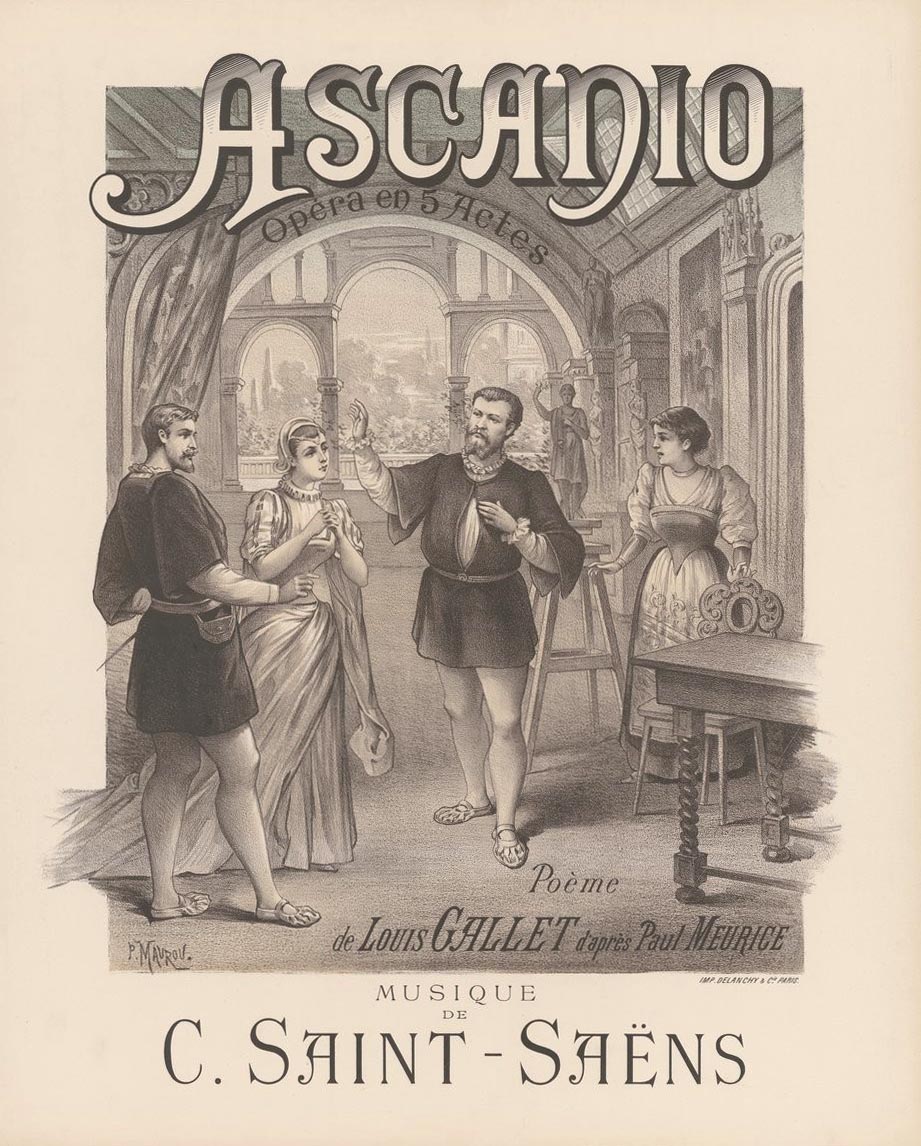
Ascanio
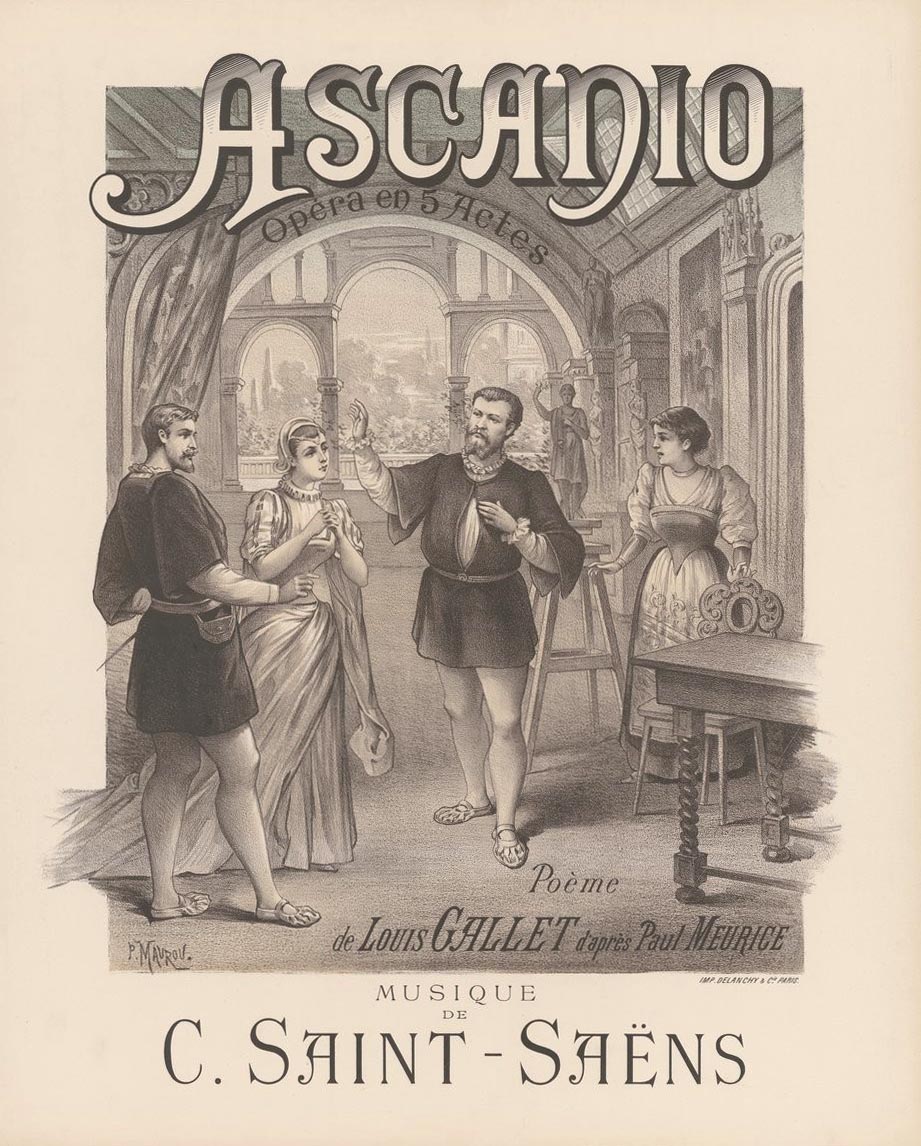
lithographie de Paul Maurou (1889)
Opéra en cinq actes et six tableaux, livret de Louis GALLET, d'après Benvenuto Cellini, drame (1852) de Paul MEURICE, musique de Camille SAINT-SAËNS (composée en 1888).
=> Ascanio de Saint-Saëns, article de Charles Gounod (23 mars 1890)
=> Notice sur Ascanio, par Charles Malherbe (1890)
Création au Théâtre de l'Opéra (Palais Garnier) le 21 mars 1890 ; mise en scène de Pedro Gailhard ; Divertissement mythologique de l'Acte III réglé par Joseph Hansen ; décors de Jean-Baptiste Lavastre et Eugène Carpezat (acte I, 2e tableau de l'acte II, acte III), Auguste Rubé, Philippe Chaperon et Marcel Jambon (1er tableau de l'acte II) ; costumes de Charles Bianchini. => maquettes des costumes pour la création
Reprise du 09 novembre 1921. Mise en scène d'Emile Merle-Forest. Ballet réglé par Léo Staats. Décors d'Alexandre Bailly et Maxime Dethomas.
Autres interprètes des principaux rôles à l'Opéra :
la Duchesse d'Etampes : Mmes Blanche d'ERVILLY (1890), Yvonne GALL (1915).
Colombe d'Estourville : Mmes Pauline AGUSSOL (1890), Amélie LOVENTZ (1890).
Scozzone : Mmes Nina PACK (1890), Consuelo DOMENECH (1890).
Benvenuto Cellini : MM. Charles BÉRARDI (1890), Jean NOTÉ (1915).
Ascanio : MM. Agustarello AFFRE (1890), Guy CAZENAVE (1915).
41 représentations à l’Opéra au 31 décembre 1961
|
personnages |
emplois |
Opéra de Paris 21 mars 1890 création |
Opéra de Paris 09 novembre 1921 35e |
Opéra de Paris 19 décembre 1921 41e |
| la Duchesse d'Etampes | soprano dramatique | Mmes Ada ADINI | Mmes Marcelle DEMOUGEOT | Mmes Marcelle DEMOUGEOT |
| Scozzone | contralto-mezzo-soprano* | Rosa BOSMAN | Lyse CHARNY | Lyse CHARNY |
| Colombe d'Estourville | soprano | Emma EAMES | Marguerite MONSY [MONSY-FRANZ] | Marguerite MONSY [MONSY-FRANZ] |
| une Ursuline | soprano | Marie NASTORG | ||
| Dame Périne | mime | MORIS | Blanche KERVAL | Blanche KERVAL |
| Benvenuto Cellini | baryton | MM. Jean LASSALLE | MM. Marcel JOURNET | MM. Marcel JOURNET |
| Ascanio | ténor | Emile COSSIRA | Paul GOFFIN | Paul GOFFIN |
| François Ier | basse | Pol PLANÇON | Armand NARÇON | Armand NARÇON |
| un Mendiant | baryton | Jean MARTAPOURA | Robert COUZINOU | Robert COUZINOU |
| Charles-Quint | basse | Eugène BATAILLE | Joachim CERDAN | Léonce TEISSIÉ |
| Pagolo | basse | Louis CRÉPAUX | Charles MAHIEUX | Charles MAHIEUX |
| d'Estourville | ténor | Jules GALLOIS | Gaston DUBOIS | Gaston DUBOIS |
| d'Orbec | ténor | Elie TÉQUI | Maurice SORIA | Maurice SORIA |
| Danse | Mlles DÉSIRÉ (l'Amour), LOBSTEIN (Vénus), GRANGÉ (Junon), KELLER (Pallas), SANDRINI (Diane), OTTOLINI (Érigone), BROT (Nicœa), CHABOT (Psyché), INVERNIZZI (la Nymphe de Fontainebleau), TORRI (Phœbus) ; MM. VASQUEZ (Bacchus), PLUQUE (le Maître des Jeux) | Mlles Carlotta ZAMBELLI (l'Amour), Anna JOHNSSON (Psyché), Camille BOS (Vénus), Yvonne DAUNT (Junon), Yvonne FRANCK (Pallas) ; MM. Gustave RICAUX, BELL, Paul PERICAT | Mlles Carlotta ZAMBELLI (l'Amour), Anna JOHNSSON (Psyché), Camille BOS (Vénus), Yvonne DAUNT (Junon), Yvonne FRANCK (Pallas) ; MM. Gustave RICAUX, BELL, Paul PERICAT | |
| Ouvriers, Apprentis, Elèves de Benvenuto, Seigneurs et Dames de la Cour de François Ier, Gardes, Hommes et Femmes du Peuple | ||||
| Chef d'orchestre | Auguste VIANESI | Reynaldo HAHN | Reynaldo HAHN |
La scène se passe à Paris, en 1539.
* Le rôle de Scozzone, écrit par l'auteur pour la voix de contralto, a été pointé pour mezzo-soprano spécialement en vue des représentations à l'Opéra.
|
Le poème de cet ouvrage n'était qu'une réduction et une adaptation lyrique d'un drame de MM. Paul Meurice et Auguste Vacquerie, Benvenuto Cellini, joué à la Porte-Sainte-Martin en 1852. Le drame était touffu, compliqué, et sa transformation musicale n'était pas chose facile ; aussi ne fut-elle pas des plus heureuses, et l'on ne peut dire vraiment que ce fut la faute de l'arrangeur, qui avait eu le tort de consentir à se charger d'une besogne presque impossible. Le musicien, malgré sa valeur, n'avait pas été beaucoup plus fortuné, et si la partition d'Ascanio contient quelques pages agréables, on peut lui reprocher à la fois son inégalité et une assez choquante diversité de formes. Il s'est produit d'ailleurs, au sujet de cet ouvrage, deux faits assez singuliers : le premier, c'est l'absence, pendant les études et la représentation de son œuvre, du compositeur, qui tout à coup avait quitté furtivement Paris et la France sans prévenir personne, sans dire où il allait, sans donner de ses nouvelles à qui que ce fût, si bien que nul ne savait ce qu'il était devenu ; le second, c'est que la répétition générale avait été navrante, que chacun prévoyait tristement pour le grand jour une chute lamentable, et que la première représentation fut au contraire brillante, vraiment intéressante et confinant au succès ; c'est qu'entre les deux un travail de remaniements, de coupures et d'arrangement avait été fait d'une façon très intelligente, qui rendait l'œuvre au moins très présentable en en faisant mieux saillir et ressortir les bonnes parties. Néanmoins, la partition d'Ascanio ne saurait compter parmi les meilleures productions de l'auteur de Samson et Dalila, de Henri VIII et de tant d'œuvres symphoniques qui révèlent un génie à la fois si souple, si mâle et si puissant. Ce qu'on peut dire d'elle surtout, et ce qui peut étonner de la part d'un artiste comme M. Saint-Saëns, c'est qu'elle manque essentiellement de personnalité. Les meilleures pages en sont, les pages épisodiques et courtes, telles que la cantilène de Benvenuto : Enfants, je ne vous en veux pas, le madrigal de François Ier : Adieu, beauté, ma mie, la jolie chanson florentine de Scozzone et la ballade de Colombe : Mon cœur est sous la pierre... Si l'on y joint l'agréable duo chanté par Benvenuto et Ascanio, on connaîtra à peu près tous les morceaux qui méritent d'être tirés de pair dans cette œuvre de valeur secondaire.
(Félix Clément, Dictionnaire des opéras, supplément d’Arthur Pougin, 1903)
|
|
Je n'ai pu m'empêcher de penser qu'Ascanio datait terriblement. L'audition de l'opéra de M. Saint‑Saëns nous ramène vraiment de trente ans en arrière et même davantage. Joliment et clairement orchestrée, cette musique coule facilement, caresse, mais on en garde peu de chose. Elle est faite avant tout pour faire valoir les voix qui la chantent ; elle s'efface devant elles, donne naissance à l'air et ne frappe l'auditeur que par des qualités toutes extérieures. L'esthétique romantique, presque mélodramatique qui est la sienne, évite le plus souvent la trivialité (ce qui est déjà un résultat notable), mais ne saurait faire impression que sur un public de bonne volonté. Quoi qu'il en soit, et, pour rétrospective qu'elle nous soit apparue, la reprise d'Ascanio n'est pas désagréable, d'autant que l'interprétation en est de premier ordre. Sauf pour Mlle Demougeot, peu faite pour le rôle de la duchesse d'Étampes, et qui pourtant fit montre de beaucoup d'autorité, aucune restriction n'est à faire dans l'éloge. M. Marcel Journet, dans le rôle écrasant de Benvenuto Cellini, est vigoureux à souhait. Sa voix chaude est très ample. Il la conduit à merveille au gré changeant de la passion. Aussi son succès (notamment dans la cantilène de l'avant-dernier tableau) fut-il grand. Dans le rôle de Scozzone (Italienne jalouse) Mme Lyse Charny fut également et pour les mêmes raisons très applaudie. Ces voix colorées plaisent toujours, surtout dans le contralto. Pour un peu, on eût trissé sa fameuse chanson florentine. Au reste, Mlle Monsy, MM. Goffin, Narçon, Dubois, Cousinou et Cerdan sont aussi à féliciter. Le ballet fut somptueux (Mlle Zambelli faisant toujours preuve de cette grâce parfaitement et mécaniquement classique qui est sienne). Il se déroula dans le meilleur des décors brossés largement par M. Dethomas.
(Jean Bernier, Comœdia illustré, 25 novembre 1921) |
|
"La la la" Chanson florentine de l'Acte II Meyriane Héglon-Leroux (Scozzone) et Camille Saint-Saëns au piano Disque Pour Gramophone 33470, mat. 3459 G, enr. à Paris le 26 juin 1904
|