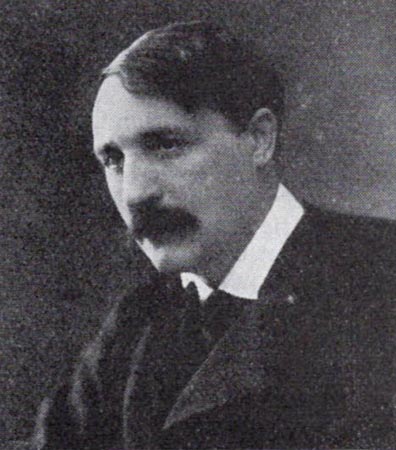
Théodore BOTREL
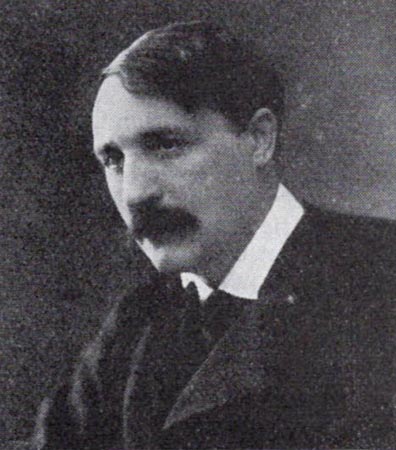
Théodore Botrel [photo H. Manuel]
Jean Baptiste Théodore Marie BOTREL dit Théodore BOTREL
chansonnier français
(Dinan, Côtes-du-Nord [auj. Côtes-d'Armor], 14 septembre 1868* – Pont-Aven, Finistère, 26 juillet 1925*)
|
chansons
Bonheur manqué, chanson, poésie de Théodore Botrel, musique de Désiré Dihau => partition Chansons pour Lison (les), 15 poèmes d’amour rustique, poésies de Théodore Botrel, musique de Désiré Dihau : Hisse la grand’ voile !... ; Lison s’en est allée… ; Soir d’été, rondeau ; Tous deux !... ; Lison est revenue ! => partitions Dans vos yeux, chanson, poésie de Théodore Botrel, musique de Désiré Dihau => partition Il était un petit navire, chanson, poésie de Théodore Botrel, musique de Désiré Dihau => partition Petit à petit, chanson, poésie de Théodore Botrel, musique de Désiré Dihau => partition Voilà Pierre-qui-Roule !..., chanson, poésie de Théodore Botrel, musique de Désiré Dihau => partition |
|
Il était né à Dinan le 14 septembre 1868, — Dinan-la-Jolie, comme il l'appelle dans un couplet où il a fixé pour la postérité divers points obscurs ou contestés de son état civil :
C'est à Dinan-la-Jolie Que j'ai vu le jour, Ruelle de la Mittrie, Dans le vieux faubourg.
Mais sa famille, son « clan », était originaire de Broons où les Botrel, de père en fils, battaient le fer. Ils essaimèrent tout autour d'eux, et l'on compte encore en haute Bretagne plusieurs forgerons du nom de Botrel. Jean-Baptiste, lui, de qui naquit Théodore, dut, en raison d'une santé précaire, renoncer de bonne heure à la profession paternelle et entrer aux gages d'un médecin, puis d'un aubergiste de Saint-Méen, finalement du maire de Dinan, Flaud. Il se maria, dans cette localité, à une couturière alsacienne ; mais, pour son malheur, à peine marié et père d'un solide garçon, il se laissa prendre, comme tant d'autres, au mirage de « la grand'ville » et partit avec sa femme pour Paris. C'était au lendemain de la guerre franco-allemande : un petit fonds de commerce « en pleine prospérité », que lui « refila » un astucieux compatriote, engloutit en moins de quatre mois les économies du ménage auquel un second fils était né.
De ce premier échec (dit Théodore Botrel dans ses Souvenirs d'un barde errant, fâcheusement interrompus par sa mort, et non recueillis en librairie), les miens ne se relevèrent jamais... Et ce fut la misère durant toute leur vie. Misère digne, convenablement vêtue, fièrement supportée, certes mais qui, d'être ignorée, n'en était pas moins pitoyable. Aussi mon père, je vous en réponds, haïssait-il Paris cordialement, comme s'il avait le pressentiment que la grand'ville serait un jour son assassin. Un tramway devra, en effet, l'écraser, boulevard Malesherbes, alors qu'il n'aura que cinquante-sept ans ; après quoi, notre mère mourra de sa mort. Étonnez-vous de mes ardentes croisades contre l'abandon des campagnes et de mon sempiternel refrain :
Notre petit coin est si doux, Vivons, aimons, mourons chez nous.
Lui-même, à peine sevré, tandis que ses parents s'en allaient chercher fortune à Paris, avait été confié à son aïeule paternelle, « grand'maman Fanchon », dont la chaumine du Parson (hameau dépendant de Saint-Méen), qu'elle partageait avec sa fille, « tante Lalie », bordait la route de Dinan à Ploërmel. Élevé par ces deux femmes indulgentes, illettrées et toutes prises encore dans l'argile originelle, Théodore mena jusqu'à sept ans une enfance mistralienne, en pleine nature, dans le commerce des petits pâtres, ses amis, et de ses oncles les batteurs de fer, établis aux environs, à Muel, en Crouais, proche de cette forêt de Brocéliande où il lui arriva un jour de s'égarer et dont les philtres montaient à son cerveau, avec des bouffées de rondes et de vieilles chansons populaires. L'une de ces chansons, la Belle Rose :
Connaissez-vous belle Rose ? (bis.) Rose. Rose est un beau nom : Verse à boire. Rose. Rose est un beau nom : Buvons donc !
dont on retrouvera le refrain et le rythme dans sa fameuse Fanchette, l'avait particulièrement séduit par sa cadence alerte. Un soir de moisson, comme à la ferme voisine, tenue par un cultivateur du nom de Le Garçon, le dernier char rentrait, paré et pavoisé, avec la dernière gerbe, l'enfant, juché sur le haut du char, se prit, comme instinctivement, à façonner sur l'air de la vieille chanson des couplets de circonstance qu'il lançait à la volée autour de lui :
C'ti qu'a les plus belles gerbes (bis), C'est le fermier Le Garçon : Verse à boire. C'est le fermier Le Garçon : Buvons donc !...
Parce qu'il va-t-à la messe (bis), Dieu lui bénit sa moisson : Verse à boire.
Dieu lui bénit sa moisson :
Peut-être n'est-ce pas le lieu de crier au miracle et à la précocité du génie, et ces couplets n'ont rien qui passe la commune mesure des improvisations enfantines ; mais il y a là pourtant comme le premier jet, la première indication d'une destinée. A ce petit « pacaut » de six ans, qui ne sait encore que sa « croix-Dieu » et qui sera le plus populaire de nos chansonniers, il n'est point indifférent que ce soit la muse anonyme et sans afféterie de la chanson populaire — et plus spécialement de la chanson française — qui ait souri la première. « O chanson populaire, s'écrie quelque part Mickiewicz, arche d'alliance entre les temps anciens et les nouveaux, c'est en toi qu'une nation dépose ses souvenirs, ses espoirs secrets et la fleur de ses sentiments ! » La haute Bretagne mentirait à son nom et à ses devoirs si elle n'était demeurée bretonne ; mais l'extérieur chez elle — l'habit, le langage — depuis des siècles est tout français. C'est une remarque dont il faudra se souvenir chaque fois qu'on parlera de Botrel : le « barde breton », comme il aimait à s'appeler et comme on l'appelait communément, supportait assez bien, aux premiers temps de sa triomphale carrière, d'ignorer totalement le langage celto-armoricain et ne s'en croyait pas moins un « barde » authentique. Il eût donc fallu aussi, rétorque-t-on, qu'il gardât l'habit des siens et n'allât point, sur les tréteaux de Montmartre, s'affubler en paysan de la basse Cornouaille, avec des bragou-braz et un gilet brodé. Mais, en ce cas, le public français, belge, canadien, etc., qui voyait en lui un barde breton, le barde breton par excellence, n'aurait-il point marqué quelque résistance, et ne comprend-on pas, dira Jean des Cognets avec infiniment de bon sens, que ce costume était son seul décor, qu'il emportait partout et dont la seule vue faisait apparaître autour de lui l'horizon d'une Bretagne idéale ? Concession peut-être nécessaire et, de toute façon, sans la moindre importance, si l'on veut bien réfléchir que les plus « représentatifs » des écrivains bretons furent ou des « gallos » ignorants comme lui de la langue celtique, un Chateaubriand, un Lamennais, un Paul Féval, un Villiers de l'Isle-Adam, ou des bas Bretons dédaigneux de cette langue pour l'expression de leur pensée, tels qu'un Brizeux et un Renan. La superstition de la langue peut conduire aux plus criantes injustices, et c'en fut une de contester à Botrel une nationalité qu'il affirmait par des signes beaucoup moins équivoques que de simples assemblages de sons ; on étonnerait sans doute bien des Bretons « intégraux » en leur révélant que le plus grand de leurs « bardes », celui peut-être pour qui l'épithète de génial n'a rien d'excessif, Jean-Pierre Calloc'h, est tout imprégné de symbolisme français et a plus fréquenté chez Viellé-Griffin et surtout chez Paul Claudel que dans les Triades et les Mabinogion... Il est seulement regrettable que l'enfance de Botrel ne se soit pas poursuivie plus longtemps dans l'Arcadie parsonienne, sous des ombrages et dans un milieu si bien accordés à ses goûts : son éclosion en sera retardée d'autant. Mais, comme il venait d'avoir sept ans, — l'âge de raison, — ses parents le réclamèrent à « grand'maman Fanchon » qui résista, pleura et dut à la fin desserrer son étreinte : le petit « Théo » partit à son tour pour « la grand'ville » et, s'il ne s'y perdit pas, il s'y dévelouta tout de même bien un peu — pas trop cependant, — grâce aux excellents maîtres et directeurs qui l'y accueillirent, le frère Alton-Marie, le frère Scipion, dans l'école congréganiste où il préparait son certificat d'études primaires, l'abbé de Bréon, l'abbé Huvelin, une des grandes figures apostoliques de ce temps, et le futur archevêque de Sens, Mgr Chesnelong, à l'église Saint-Augustin, sa paroisse. Cette formation toute catholique, autant que ses dispositions naturelles, l'a marqué profondément, et l'on ne voit pas qu'à aucun moment de sa vie, même quand il courait le « cachet » dans les cabarets nocturnes de Montmartre, il ait éprouvé la moindre crise religieuse et senti fléchir sa foi — une robuste foi de charbonnier et de Breton. Pour l'instant, il en est loin, de ce Montmartre. A peine son certificat décroché, son père l'a mis en apprentissage chez un serrurier, d'où il passe, la vocation tardant, chez un éditeur de musique, puis chez un joaillier lapidaire et enfin chez un avoué lettré et homme du monde, Me Ernest Denormandie, qui l'embauche comme saute-ruisseau. Mais cette étude est, à certains jours, un cénacle de beaux esprits : on y voit des gloires, naissantes ou déjà consacrées, du barreau, de la politique et du théâtre : Henri-Robert, Manuel Fourcade, Raymond Poincaré, Henri Becque, Jules Claretie ; le « patron », en qualité d'avoué de la Comédie-Française, dispose de billets de faveur dont la manne descend parfois jusqu'à l'humble petit clerc, — et c'est ainsi qu'un certain 14 juillet il put assister à une représentation de Ruy Blas donnée en présence de Victor Hugo, qui se leva au bord de sa loge et à qui la salle fit une ovation pareille à celle que, cent ans plus tôt, elle avait faite à Voltaire. « Parisiens, vous voulez donc me faire mourir de plaisir », s'écriait Voltaire. Hugo, plus olympien, se contenta de saluer. Ces basochiens, au milieu desquels sa bonne étoile, aidée par le directeur du patronage Saint-Augustin, avait introduit le jeune Botrel aux environs de sa quatorzième année, « parlaient fort peu procédure, dit-il dans ses Souvenirs, et beaucoup théâtre et littérature ». Mais qu'en restait-il dans le cerveau inculte de leur petit auditeur ?
Et comme, tout à coup (dit-il), mon éducation m'apparut précaire ! Oh ! il me fallait coûte que coûte la compléter. Et je me lis inscrire aux cours du soir des Associations polytechnique et philotechnique de mon quartier... Chaque soir donc, ma journée finie, j'allais à mes conférences, de 8 h. 1/2 à 9 h. 1/2... (Mais) le cours post-scolaire suivi le plus régulièrement par moi était celui de lecture et de déclamation. Il était fait rue Caumartin par un étrange professeur, sans grande allure, mais non sans talent, nommé Marius Lainé, haut comme trois pommes, légèrement bossu, longs cheveux « à la Mendès », toujours vêtu d'une sévère redingote de notaire... Au théâtre, il eût été le plus quelconque des acteurs. Comme professeur, il était incomparable...
Botrel lui dut ses premiers succès dramatiques à l'Amicale des anciens élèves de Saint-Augustin, dont, à son tour, il forma la troupe et où il fit même jouer une pièce de lui, la première en date, le Poignard, demeurée au répertoire des patronages — un petit mélo historique, très noir, mais très moral et sans personnage féminin, bien entendu. Il avait le pied à l'étrier, mais un pied seulement : auteur-acteur, il ne s'était pas encore découvert — ou redécouvert — chansonnier. Cela ne tarda guère, mais le public, cette fois, ne fut plus celui des patronages. Il y avait en ces âges lointains, dans le VIIIe arrondissement, un petit café-chantant honnête et d'allure provinciale, le Concert de la Pépinière, fréquenté par les familles du quartier :
Je m'y risquai (dit Botrel) à soumettre mes compositions au régisseur, gros brave homme appelé Émile Durafour. Quand l'une d'elles lui plaisait, il la signait avec moi et en touchait les droits d'auteur. Je lui apportai ainsi le Petit Bois de Kéramour, le Duel d'oiseaux, que nous chanta une gentille artiste nommée Fredy, la Chanson de Pascalou, que nous créa la célèbre Juana. Par ailleurs, le propre neveu d'Émile Durand me musiqua Au son du biniou, ma première chanson imprimée, éditée qu'elle fut par Gauvin...
Il avait dix-huit ans et il continuait à gagner soixante-quinze francs par mois, doublés, il est vrai, par les copies qu'il grossoyait la nuit et dorés par l'espoir d'entrer quelque jour, comme expéditionnaire, à la Compagnie du P. L. M., dont le sénateur Denormandie, père de son « patron », était un des administrateurs, ou à la Banque de France, dont il était gouverneur. Mais, pour atteindre à ces sommets, il fallait avoir satisfait aux obligations du service militaire. Bravement notre « Théo » s'engagea pour cinq ans, à Rennes, au 41e de ligne. Il en revint avec les galons de sergent et, presque aussitôt, en effet, vit s'ouvrir toutes grandes devant lui les portes du P.-L.-M. C'était la « matérielle » assurée. Le premier usage qu'il en fit fut de s'inscrire aux cours payants de déclamation fondés par la vieille actrice Scriwannek, chez laquelle il connut une gracieuse débutante luxembourgeoise, Hélène Lutgen, — la future « Léna » des Chansons de chez nous, — qu'il allait épouser. En même temps il s'enrôlait comme volontaire — non payant, cette fois, mais ni payé non plus — dans la troupe du Théâtre-Libre où, sous le nom de sa mère, déjà illustré par un grand acteur de l'époque romantique, Fechter, il créa divers rôles de second plan à côté d'Antoine. Les pièces personnelles cependant — Nos bicyclettes, Monsieur l'Aumônier, etc., — se multipliaient sous sa plume, et le public des patronages leur faisait fête. Quant aux chansons, il ne les comptait plus. Seulement, il n'avait pas de salle où les produire lui-même, en dehors de ces mêmes patronages. Paul Delmet se rencontra tout à point pour le tirer d'embarras. Botrel lui avait envoyé deux petits poèmes : les Mamans et Quand nous serons vieux, qui plurent à l'aimable musicien dont c'était alors la grande vogue, qu'il « musiqua » et fit entendre au Chien-Noir, nouveau cabaret fondé par Victor Meusy avec Delmet et quelques autres dissidents de « la boite à Salis ». Au cours de la séance, un chansonnier vint à manquer : Meusy, avisant Botrel dans les coulisses, le poussa sur la scène en alléguant que, puisqu'il se disait chansonnier, il devait savoir chanter : « Mais je n'ai pas de partition ! protesta Botrel. — Ça ne fait rien, dit le pianiste pour appuyer Meusy. Partez toujours, je vous suivrai de mon mieux. Rendez-vous au point d'orgue. » Et c'est ainsi que fut « créée », sur une musique improvisée, la Ronde — aujourd'hui célèbre — des châtaignes. Séance tenante — à moins que ce ne fût un peu plus tard, — Botrel était engagé par le directeur du Chien-Noir, comme chansonnier ordinaire, aux appointements mirifiques de cinq francs par soirée.
J'avais goûté (écrit-il) à cette joie ineffable d'être « le chansonnier dans ses œuvres ». Défendre soi-même ses enfants, pousser soi-même son cri (maladroit, intempestif peut-être, mais sincère), quelle ivresse c'était !... Quel apostolat ce pouvait être ! Ah ! oui ! le « parolier » était bien mort en moi ! Le « chansonnier » venait de naître.
Et l'on peut dire un grand chansonnier, le successeur direct de Béranger, de Pierre Dupont et de Nadaud. Mais cette partie de la vie de Théodore Botrel est si connue qu'il est permis de s'en tenir désormais à quelques dates et à quelques titres de chansons ou de recueils. Aussi bien, la vrai notoriété du « barde » date-t-elle d'un peu plus tard : il la dut à la Paimpolaise, qui n'est peut-être pas la meilleure de ses chansons, mais qui, venant après le chef-d’œuvre de Loti, Pêcheur d'Islande, bénéficia de la rumeur d'admiration soulevée par l'incomparable églogue marine et en apparut comme la condensation populaire. Botrel y avait commis maints solécismes, imputables à sa formation terrienne, et fait pêcher notamment la morue à l'aide de harpons, — comme la baleine. Rien n'y fit, et les pêcheurs eux-mêmes, islandais et terre-neuvas, surent bientôt par cœur la mélancolique complainte dont les paroles leur importaient moins que la nostalgie vague qui l'imprégnait :
Quittant son clocher et sa lande, Quand le Breton se fait marin...
La Paimpolaise, vendue à un éditeur parisien et tirée à des millions d'exemplaires, avait rapporté vingt francs à son auteur ; mais, si le profit matériel était faible, le profit moral fut énorme et s'affirma quelque temps après (1898) par l'accueil enthousiaste que le public fit aux Chansons de chez nous. Par « chez nous », l'auteur n'entendait pas seulement que son petit coin de terre dinannais, retrouvé pendant son service et où il passait la plupart de ses permissions : il avait agrandi son horizon dans l'intervalle et, au Port-Blanc, pendant les « vacances », dans le commerce quotidien d'Anatole Le Braz, poussé en largeur et en profondeur sa culture bretonne, encore bien superficielle. Les Chansons de chez nous prétendaient être et, de fait, étaient bien réellement les chansons du peuple breton tout entier, l'expression naïve de sa sentimentalité rêveuse, de son inquiétude et de son besoin d'au-delà. Toutes les chansons du recueil ne se valaient pas sans doute et, à côté de vrais chefs-d’œuvre du genre, comme le Vœu à saint Yves, le Petit Grégoire, la Fanchette, Noël à bord, les Gars de Morlaix, il s'y trouvait bien du fatras, de l'à-peu-près. Et c'est le reproche, justifié en partie, qu'on ne manquera pas d'adresser aux recueils suivants de l'auteur : les Contes du lit clos (1899), Chansons de la fleur de lys (1900), Coups de clairon (1901), Chansons en sabots (1902), Chansons en dentelles (1905), Chansons de Jean-qui-chante (1910), Chansons des clochers à jour (1911), les Alouettes (1912), Chansons de la veillée (1913), les Chants du bivouac (1915), Chansons de route (1916), Chants de bataille et de victoire (1919). Des trous, de soudaines défaillances, étaient inévitables dans une production si copieuse, à laquelle il faut ajouter les innombrables pièces de théâtre pour patronages ou que Botrel inscrivait au programme de ses représentations personnelles, quand il commença de battre l'estrade en France et à l'étranger : la Voix du lit clos, Fleur d'ajonc, Doric et Léna, la Médaille du pilote, Notre-Dame-Guesclin, Jean Kermor, etc. Et, peu content de courir ainsi le monde, avec sa fidèle « Léna » et son accompagnateur Coulomb, il lançait en 1908 et dirigeait jusqu'aux premiers mois de la Guerre une revue mensuelle de musique et de poésie, la Bonne Chanson, dont il était le principal fournisseur en même temps que le directeur ; à Pont-Aven, où il avait transporté sa tente et dont le décor charmant, un peu conventionnel, fleuri de coiffes blanches et de collerettes tuyautées, réalisait merveilleusement la Bretagne d'idylle qu'il portait en lui, il fondait ce pardon des Fleurs d'ajonc, une des grandes « attractions » de la Bretagne estivale. C'est à Pont-Aven même, où il avait enterré, en 1916, sa chère Léna et où il se reposait, entre ses deux enfants et la nouvelle et toute dévouée compagne qu'il avait épousée en 1919, à Colmar, au pays de sa mère, que la mort le surprenait l'été dernier, tandis qu'il rédigeait ses Souvenirs d'un barde errant. Dinan, sa ville natale, Paimpol, qu'il célébra, Pont-Aven, qui lui fut une seconde patrie, rivalisent aujourd'hui pour commémorer sa mémoire. Pieuse et rare émulation, qui dit assez quels liens étroits s'étaient tissés entre la Bretagne et son « barde » d’élection. Nous avons fait nous-mêmes, au cours de cette longue biographie, toutes les réserves qui s'imposaient sur le caractère et la qualité de son œuvre de chansonnier, la seule vraisemblablement que l'avenir retiendra ; cette œuvre, tout d'une coulée, n'est pas partout du même métal : elle sonne le creux en maints endroits. La langue en est pauvre, mais la langue des chansons populaires n'est pas sensiblement plus riche, et elle suffit. Un raffiné n’eût pas été à sa place, ici et Botrel, dans ce rôle de chansonnier populaire qu'il avait assumé, était servi par ses défauts mêmes, — si c'en est un de ne pas être un mandarin ou un joaillier de lettres. J'irai jusqu'au bout, et j'oserai dire que les vraies taches, les seules peut-être, qu'on relève dans cette œuvre toute d'instinct et d'effusion naturelle, sont celles qu'une certaine prétention à l'élégance littéraire y a introduites çà et là. Mais, taches, dissonances, incorrections même, le rythme emporte tout. La chanson est, par excellence, une chose de plein vent, ailée, vibrante et vivante. Et l'on peut dire en toute certitude, de Botrel, qu'il fut la Chanson faite homme, — une chanson mâle, patriote, la plus fortifiante qu'ait entendue notre âge, la plus nostalgique aussi, quelquefois.
(Charles Le Goffic, Larousse Mensuel Illustré, avril 1926)
|